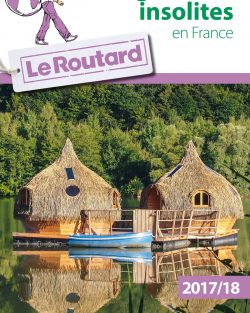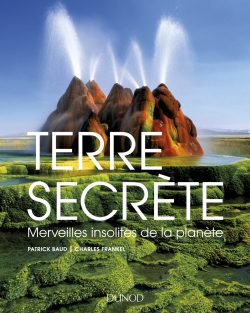Punta Arenas, janvier-février 2019.
Je suis amoureuse du Détroit (el Estrecho).
J’y vais presque tous les jours.
Il est chaque fois différent, selon le ciel, les nuages, la couleur de l’eau. Mais il y a toujours des oiseaux et toujours de gros bateaux.
La pêche a été bonne. Le bateau est rentré au port ; pas la peine de continuer, les frigos sont pleins, les marins fatigués et gelés.
Cette nuit, ils ont remonté, dans le fracas des vagues et des poulies, des filets lourds et pleins d’une masse colorée, mouvante et muette.
Les spots éblouissent la nuit noire, le bateau a réduit son allure. Les yeux, les bras, les corps sont tendus vers les vagues qui heurtent le bastingage. Les crochets happent le filet. Le palan hisse la lourde nasse dégoulinante d’eau noire et glacée dans un vacarme de chocs, de chutes et dans le tumulte de la mer.
Des poissons de toutes tailles entremêlent dans des secousses brutales leurs queues et leurs nageoires. Des coquillages tombent sur le pont à travers les mailles du filet. Des étoiles de mer, victimes collatérales du raclement des fonds, pendent, flasques et ternes. Des crabes et araignées de mer serrent leurs pattes et pinces en mouvements spastiques.
Les projecteurs éclairent violemment cette masse mourante. Les plus petits renoncent vite et leurs derniers mouvements de vie cessent dès leur sortie de l’eau. Les plus gros se défendent, avec l’énergie de la pulsion vitale. Le plancher du pont a disparu sous le monceau pêché.
La lumière blanche et crue lui donne des couleurs étranges : certains reflets jaunes ou orange, effervescents, strient par éclats les gris argentés dominants, les écailles luisent d’éclats argentés qui s’éteignent en une irisation furtive, une tache blanche, une noire, la lumière refletée dans un œil encore vif.
Nous travaillons vite : séparer les coquillages, rejeter les étoiles de mer et les petits organismes, assommer les plus gros, les plus résistants, jeter les crustacés dans des bacs, lancer les poissons dans le toboggan qui les conduira dans la cale où ils seront nettoyés, vidés, parfois décapités, puis congelés.
Il fait froid dans ces coins de pêche au sud du sud, nos mains s’engourdissent, nos bras et nos jambes bougent mal, engoncés dans nos cirés rigides. Nous travaillons vite, sans réfléchir, sans parler, sans regarder.
Si je raconte aujourd’hui avec détails ce que j’ai vu sur le pont, cette nuit, avant mon retour au port, si je me rappelle les poissons, les étoiles de mer, les crabes et les araignées de mer, si me reviennent les sons et les images, c’est parce qu’un œil a attiré mon attention. Un œil qui me parut familier.
Rond, il luit encore alors que le poisson agonise. En son centre, la pupille noire reste fixe face au spot qui l’éblouit. Elle est bordée par l’auréole d’un iris vert irrigué de veinules marron et grises. La paupière qui le cerne est rougie. Je ne peux détacher mon regard de l’animal, un grand saumon, aux reflets argentés, encore humide, encore agité de soubresauts, encore vivant.
Mes mains travaillent sans moi, je trie, je lance, je ramasse, je lance plus loin, j’assomme, j’attrape, je serre, je frappe, je trie, je lance encore.
Je frappe le saumon aux yeux verts irisés de marron, je le jette dans la cale.
Mes mains ramassent, trient, piochent dans la masse mouvante, lancent, frappent, serrent, lancent, piochent, lancent, piochent, jettent.
Nous finissons au petit matin, gelés, harassés, muets.
Nous nous glissons dans nos cabines.
Je me débarrasse de ma carcasse cirée couverte de sang, de sel et d’algues. Dans la minuscule salle de bains, mon regard s’arrête sur mon visage que reflète le miroir. M’y regardent deux yeux verts irrigués de veinules marron et grises, cernés par une paupière rougie.
Marie-Françoise Govin